| Acceuil |
| Avoir un chat |
| Anatomie et santé |
| Histoire du chat |
| Principales races |
| Renseignements utiles |
| Bibliographie |
Pourquoi les chats voient-ils la nuit ? Comment est fait leur squelette ? Pourquoi ne voit-on pas toujours leurs griffes ? Comment se reproduisent-ils ?
Anatomie Générale
Souple, solide, parfaitement adapté pour le chasse et les galipettes,
le squelette du chat est très semblable à celui du tigre.
Les vertèbres sont tenues par des muscles et des ligaments plus
souples que chez l’homme qui lui permettent de bondir, grimper aux
arbres, courir, s’étirer et lécher les moindres parties
de son corps. A la base de la langue se trouve l’os hyoïde
qui permet au chat de ronronner. Son crâne est pourvu de grandes
orbites rondes et de dents acérées idéales pour tuer.
Chez certaines races, comme les persans, le museau est si aplati qu’il
y a tout juste la place pour les dents : les fosses nasales exiguës
forcent l’animal à « ronfler »
Les griffes sont rétractiles. Rétractées, elles pivotent
vers le haut avec les phalanges qui les portent sur la tête des
deuxièmes phalanges, en rentrant dans un étui de peau. Elles
sortent très vite, grâce à des muscles protecteurs,
tandis que les doigts s’écartent.
Le système musculaire est particulièrement puissant aux
épaules. Il permet aux chats de bondir sur ses proies.
L’appareil digestif occupe toute la cavité abdominale. La
digestion se déroule comme chez l’être humain. 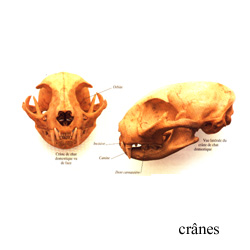

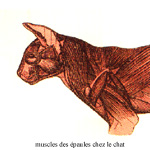
La tête
Les chats ont de grands yeux ronds qui leur procurent un large champ visuel.
Dans le noir, la pupille se dilate pour capter le plus de lumière
possible. A la lumière, elle se contracte jusqu’à
devenir une fente étroite. La nuit, le chat voit bien grâce
à un miroir situé derrière la rétine le tapetum
lucidum, qui réfléchit la lumière.
Les moustaches, scientifiquement nommées vibrisses, possèdent
des terminaisons nerveuses à la racine et sont disposées
de manière à toucher les objets proches. Lorsqu’il
fait trop sombre, elles relaient la vue.
La langue a plusieurs utilités. Elle sert à manger, bien
sûr, mais aussi à se laver. Sa surface est garnie de papilles
dures, hérissées en arrière. Elle prend la forme
d’une cuiller pour laper l’eau, ou d’un peigne à
fourrure lors de la toilette.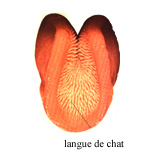
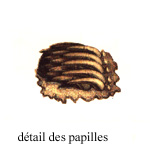
La fourrure
La plupart des chats possèdent un pelage à deux couches.
La couche supérieure est colorée, protectrice et constituée
de longs poils, les poils de garde. La couche inférieure est constituée
de poils courts, doux et bouffants et d’autres, un peu plus longs
et durs. Dans la nature, les chats s’adaptent aux saisons en perdant
leurs poils deux fois par an. Un nouveau pelage vient remplacer l’ancien,
épais en hiver, léger en été. Mais nos chats
domestiques ne suivent plus la mue. Ils perdent quelques poils au long
de l’année.
Reproduction
Un chat, mâle ou femelle, peut se reproduire dès 8 mois.
Une portée comporte en moyenne 3 à 6 chatons, mais certaines
portées extraordinaires peuvent aller jusqu’à 12 chatons.
Au moment des chaleurs, la chatte miaule, effectue des piétinements
avec ses pattes arrières, se roule sur le sol, se frotte aux meubles,
est plus câline et moins agressive envers les mâles. Lors
de l’accouplement, le mâle se place derrière la femelle
et lui mord le cou afin de l’immobiliser. La femelle s’accouplera
ainsi avec plusieurs mâles et pourra avoir des petits de chacun
d’eux. Elle portera ses petits durant 63 à 65 jours.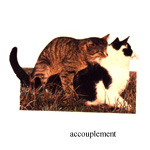
Une chatte enceinte semble inquiète, dort et mange plus. Elle recherche
l’affection des membres de la famille. A 2 à 3 semaines,
ses mamelles gonflent et rosissent. Au 2eme mois, son ventre s’arrondit.
Pendant les derniers jours, la mère miaule souvent et cherche un
endroit calme pour mettre bas. Si elle est habituée à un
endroit particulier, il se peut qu’elle aille s’y réfugier.
Les premières contractions sont faibles puis s’accentuent
petit à petit. Un premier chaton apparaît. Sa naissance est
souvent la plus longue et douloureuse pour la mère. Il naît
entouré d’une poche des eaux qui se rompt spontanément
ou est déchirée par la mère. Le placenta, ingéré
ensuite par la mère, le suit quelques minutes après. Par
la suite, les chatons mettent entre quelques minutes et une heure pour
naître. Une période de repos de 3 mn à 2h sépare
les naissances. Un accouchement dure au total entre 1 et 8h. il n’y
a pas d’inquiétude à avoir si le chaton sort en présentation
postérieure. En effet, près de la moitié des chatons
naissent de cette manière.
Reconnaître les mâles et les femelles est très simple
: il suffit d’observer le derrière des petits. Chez la femelle,
la vulve est très proche de l’anus alors que chez la mâle,
le pénis est séparé de l’anus par deux petites
protubérances correspondant aux testicules.
Si la femelle ne s’occupe pas de ses petits, il faut les sécher
avec un serviette chaude et débarrasser leurs narines du mucus
qui les encombre. Lorsqu’ils respirent, sectionner les cordons ombilicaux
par élongation entre deux compresses, sans tirer sur l’ombilic,
à 3 ou 4cm de sa base. Enfin, placer les petits près des
mamelles afin qu’ils puissent téter.
2) Développement des petits
Les chatons naissent aveugles et sourds. Ils s’orientent grâce
à l’ouïe et au toucher. Ils entendent à partir
du 5ème jour mais l’ouïe ne fonctionne complètement
qu’au 14ème jour. Les yeux s’ouvrent entre le 7ème
et le 10ème jour. A 3 semaines, les chatons coordonnent mieux leurs
mouvements. Ils ont les pattes arquées car le sens de l’équilibre
n’est pas encore totalement développé. Ils jouent
entre eux et explorent leur environnement.
Le sevrage débute vers la fin de la 3ème semaine. Il faut
mettre à la disposition des petits une bouillie lactée dans
laquelle on introduira les futurs aliments. Vers 7 semaines, tous les
petits doivent être sevrés.
3) Contraception
La venue au monde de chatons est un événement formidable,
mais certaines familles redoutent les naissances. Il existe plusieurs
moyens efficaces de contraception.
Le plus radical, définitif et économique est bien sur d’opérer
son chat. On peut stériliser un petit dès 3 mois, et il
n’est pas nécessaire pour les femelles d’avoir eu une
portée pour supporter l’intervention. Il faut compter 60
euros pour un mâle et 90 euros pour une femelle en moyenne. Mais
les prix varient d’un vétérinaire à l’autre,
et les plus chers ne sont pas forcément les plus compétents.
Outre la stérilisation, il existe pour les femelles des pilules
et injections contraceptives efficaces mais attention, plusieurs cas de
cancers des mamelles ont été détectés chez
des individus utilisant ce genre de produits.
SANTE PREMIERS SOINS
Maladies, parasites, accidents…Nos compagnons sont la proie de nombreux maux. Comment les prévenir et/ou les traiter en première urgence.
I- Les principales affections virales du
chat
LE TYPHUS
Une des plus graves maladies contagieuses félines. On remarque
une fièvre importante (40°) doublée d’une perte
d’appétit souvent accompagnée par des diarrhées
et des vomissements. Sans traitement, la mortalité est importante.
LE CORYZA
Le « rhume » des chats. Le chat est fiévreux (truffe
humide) abattu et perd l’appétit. Les symptômes les
plus répandus sont les éternuements et les écoulements
au niveau du nez et des yeux. Des antibiotiques prescrits par un vétérinaire
guériront rapidement l’animal.
LA LEUCOSE
La leucose féline est une maladie contagieuse due au virus leucemogène
félin (FeLV). Ce virus identifié par Jarett en 1964 appartient
à la famille des rétroviridés comme le virus du SIDA.
C’est un virus oncogène, c’est à dire capable
d’entraîner la cancérisation des cellules qu’il
infecte et de conduire à l’apparition de lymphosarcomes ou
de leucémies. Son issue est inévitablement fatale.
LA RAGE
Maladie incurable et mortelle pour le chat qui atteint l’homme et
tout les animaux à sang chaud. La contamination se fait par morsure
ou griffure.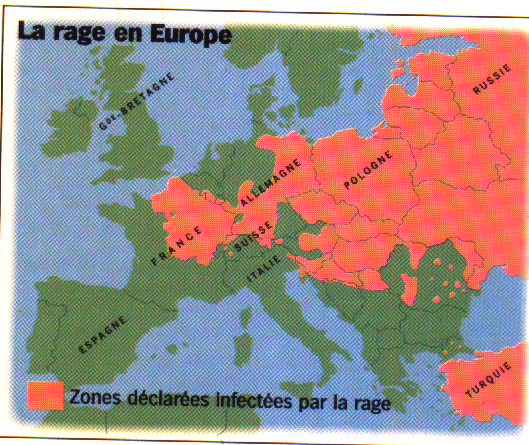
Le meilleur moyen de prévenir ces maladies est bien sur, la vaccination. Faire les rappels annuels est nécessaire, et obligatoire.
II- Parasites
Externes
LES PUCES
Les puces du chat (Ctenocephalides felis) sont de minuscules insectes
bruns (2 mm) au corps plat. Elles n’ont pas d’ailes mais de
très puissantes pattes arrières qui leur permettent de faire
des sauts de 80 cm (ce qui équivaut à un saut de 500 m pour
un humain). Elles se transmettent par contact direct ou par le milieu
extérieur. Leur présence est très désagréable
et entraîne des démangeaisons. Elles transmettent parfois
un ténia à l’animal.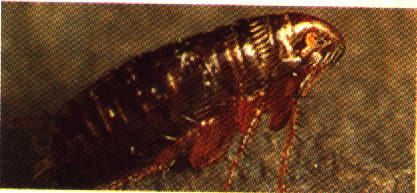
LES TIQUES
Les tiques sont des insectes marron de 3 à 16 mm quand elles sont
repues de sang. Elles s’attrapent le plus souvent en été
dans les sous-bois, les broussailles et les hautes herbes. Elles n’occasionnent
que de très rares démangeaisons, juste des réactions
locales inflammatoires. En trop grand nombre, elles causent parfois une
anémie. Le réel danger vient du fait qu’elles peuvent
transmettre des maladies parasitaires graves : piroplasmose, maladie de
Lyme, ehrlichiose…
LES AOUTATS
Les aoûtats sont les larves d’un petit acarien (Trombicula
autumnalis). Les adultes vivent sur les végétaux dans les
prairies et jardins. Les larves, rouges orangées, munies de six
pattes, éclosent d’œufs pondus dans le sol. Elles se
nourrissent de sang et se fixent sur la tête, le cou, les aisselles,
le ventre, les oreilles ou les espaces interdigités. Leurs piqûres
provoquent de très violentes démangeaisons, et elles apparaissent
à l’œil nu comme de minuscules grains oranges.
LA TEIGNE
C’est une affection très fréquente de la peau due
à des champignons dermatophytes : Microsporum canis (90% des cas),
Microsporum gypseum et Trychophyton mentagrophites. La contamination se
fait par simple contact avec un animal teigneux ou un environnement infecté.
On la rencontre surtout chez les chatons. La teigne se traduit par des
lésions rondes (1 à 5 cm de diamètre) sans poils,
rougies, recouvertes de pellicules, mais qui ne semblent pas gêner
l’animal. Il existe également une forme suppurée,
plus rare, aux lésions inflammatoires recouvertes de croûtes
(kérion).
LA GALE DES OREILLES
Plus fréquente chez les jeunes, elle est due à la présence
d’un acarien (Otodeches cynotis) qui vit à la surface de
la peau et se nourrit de débris cutanés. L’oreille
est très enflammée et remplie d’un cérumen
brun noirâtre très nauséabond. Sans traitement, cette
affection se transforme en infection microbienne (otite). Le remède
est simple, il suffit de retirer le cérumen puis d’appliquer
un acaricide prescrit par un vétérinaire.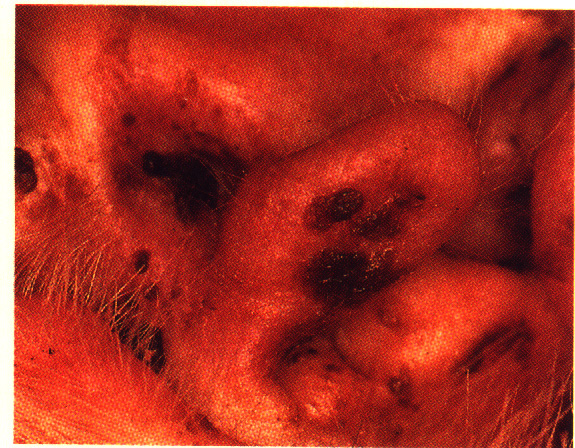
Internes
L’ASCARIS
Nombre de chatons sont affectés par l’ascaris dès
la naissance. Pendant la gestation, des larves d’ascaris hébergées
par la mère passent par le placenta et viennent parasiter les fœtus.
La contamination se fait également par le lait. Enfin, elle peut
résulter de ‘l’ingestion d’œufs et de larves
provenant des petits où de la mère elle-même. L’adulte
attrape ces vers en mangeant de l’herbe, des matières souillées,
où des animaux contaminés (notamment de petits rongeurs).
Il existe plusieurs espèces d’ascaris, mais le plus fréquent
est le Toxocara Catis, qui mesure 5 cm à l’âge adulte.
Ils sont ronds et ont une couleur jaunâtre. Ils occupent l’intestin
grêle, mais se déplacent dans le duodénum et l’estomac
d’où ils peuvent être vomis. Les larves, quant à
elles, migrent dans divers viscères et organes (foie, poumons,
muscles, diaphragme, reins, mamelles,…). Ils entraînent des
troubles digestifs (diarrhées, vomissements et quelques fois occlusion
digestive mortelle) et de la toux. Les jeunes sont affaiblis, l’efficacité
des vaccins diminuée, et les défenses immunitaires baissent.
Certaines larves migrantes atteignent même le cerveau et provoquent
des crises d’épilepsies. Les premiers vers adultes apparaissent
dans les selles à la fin de la première semaine d’infestation.
LE TENIA
Les ténias font partie de la famille des cestodes. Ils sont très
longs (Dypilidium Caninum : 20 à 80 m ; Tenia Hydatigena : 1,5
à 2 m) et possèdent une tête pourvue de crochets et
de ventouses qui se fixent sur la paroi intestinale. Ils se composent
de nombreux anneaux qui se développent à partir de la tête.
Lorsqu’ils sont murs, les anneaux remplis d’œufs se détachent
et sont expulsés avec les selles. Chaque œuf est embryonné
et contient un embryon hexacanthe pourvu de six crochets. Les chats contractent
ces vers en mangeant des rongeurs infectés où en avalant
des puces. Quand ils n’en hébergent que quelques uns, ils
n’en éprouvent aucune gêne importante. En revanche,
une infestation importante entraîne coliques, diarrhées,
amaigrissement et perte d’appétit.
Colliers, vermifuges, pipettes… Les moyens d’éviter ces parasites sont nombreux et peu coûteux. Aucune loi n’oblige à protéger son animal, mais le bien-être du compagnon et de son maître dépendant en partie de cela, il est préférable d’user de ces produits.
III- Réflexes pratiques
Quelques manipulations rapides en cas d’accident où de maladies
bénignes.
Piqûres de guêpe où d’abeille
Bénignes sauf en cas d’allergie ou de piqûres dans
l’arrière gorge
- Retirer le dard avec une pince à épiler
- Appliquer une compresse d’eau froide ou des glaçons
- En cas de réaction allergique (gonflements, difficultés
respiratoires, démangeaisons) conduire l’animal immédiatement
chez un vétérinaire
Brûlures
- Ecarter le chat de la source de chaleur
- Asperger d’eau froide la brûlure pendant plusieurs minutes
- Dégager la zone à l’aide de ciseaux
- Désinfecter et appliquer une crème cicatrisante
- En cas de brûlure profonde ou étendue, couvrir avec un
linge humide et conduire l’animal chez un vétérinaire
Plaies
- Dégager la plaie à l‘aide ciseaux à bouts
ronds
- Nettoyer au savon antiseptique ou de Marseille. Ne jamais utiliser d’alcool
qui irrite et risque de rendre le chat agressif
- Appliquer le savon avec une compresse ou un linge propre
- Sécher la plaie avec une compresse et appliquer une solution
antiseptique ou une pommade antibiotique cicatrisante.
- En cas de plaie importante, se contenter de protéger la plaie
avec une compresse et emmener l’animal chez un vétérinaire
Abcès
Si une plaie n’est pas soignée immédiatement, elle
peut aboutir à la formation d’un abcès. La plaie devient
chaude, douloureuse, puis l’abcès mûrit et une poche
de pus se forme.
- Afin de faire mûrir l’abcès, appliquer plusieurs
fois par jour des compresses chaudes imbibées d’une solution
antiseptique
- Si l’abcès se perce spontanément, nettoyer la plaie
avec un désinfectant en appuyant légèrement pour
favoriser l’évacuation du pus
- Si au bout de quelques jours l’abcès ne se perce pas, il
faudra alors l’ouvrir chirurgicalement, chez un vétérinaire.
Empoisonnement
De nombreux produits que nous utilisons tous les jours peuvent se révéler
être des poisons mortels pour les animaux (et jeunes enfants –
attention, ne pas appliquer ces méthodes sur vos enfants, les conduire
immédiatement aux urgences de l’hôpital le plus proche)
un peu trop curieux. Même une plante apparemment inoffensive peut
renfermer une sève toxique…
- Si le poison a été ingéré il y a moins de
3 heures, que ce n’est pas un produit corrosif, et que le chat n’est
pas trop choqué, faire vomir l’animal en le forçant
à boire de l’eau très salée (1 à 3 cuillères
à café de sel dans un verre d’eau tiède)
- Après les vomissements, lui administrer par la bouche du charbon
végétal activé afin de neutraliser les restes du
produit toxique présents dans son appareil digestif
- Le lait n’est pas un antidote. Au contraire, dans certains cas
(insecticides, désherbants…), les matières grasses
qu’il contient accélèrent les effets du poison.
- Si l’animal ne parvient pas à vomir, si l’ingestion
de produits a eu lieu il y a plus de 3 heures (où si le moment
de l’ingestion reste inconnu), ou bien si le chat présente
des symptômes (vomissements, diarrhées, tremblements, salivation...)
le conduire immédiatement chez un vétérinaire. Si
possible, emporter l’emballage du poison, car son identification
permet un diagnostic plus rapide et efficace.
Transporter un chat blessé
Un animal blessé développe des instincts de survie parfois
agressifs. C’est pourquoi il est important de prendre des précautions
avant de déplacer un animal
- S’approcher de l’animal doucement, en parlant gentiment
afin de le rassurer
- Le manipuler très délicatement. Si le chat est agressif,
mettre des gants (jardinage par exemple), et l’envelopper dans une
serviette de toilette en ne laissant que la tête dépasser
- Placer l’animal dans une caisse de transport fermée
- Prévenir le vétérinaire avant de partir
Hémorragies
- Appliquer un gros morceau de coton enveloppé dans une compresse
sur la plaie
- Presser la blessure pendant plusieurs minutes
- Maintenir la compresse avec une bande collante de type h
- Si l’hémorragie ne cesse pas, mettre un garrot en place.
Appliquer un garrot
Un gros élastique large, une chambre à air, une paire de
bretelles, peuvent éventuellement remplacer le garrot de caoutchouc
utilisé par les professionnels. Un garrot doit toujours être
posé sur le membre, entre le cœur et la blessure. Il arrête
l’hémorragie en comprimant les vaisseaux sectionnés
mais ne convient qu’aux blessures graves des membres et de la queue
(section, écrasement) contre lesquelles aucune autre technique
n’est envisageable.
- Serrer le garrot jusqu’à ce que l’hémorragie
s’arrête
- Une fois serré, faire un nœud avec une boucle pour faciliter
son dénouement et glisser u crayon, un stylo où une règle
en plastique sous le garrot. Ce mécanisme permettra de serrer et
desserrer le garrot en tournant le crayon dans un sens où dans
un autre.
- Ne laisser le garrot que le temps de conduire l’animal chez le
vétérinaire. Si le trajet dure plus d’un ¼
d’heure, desserrer à intervalles réguliers pour ne
pas couper complètement la circulation du sang dans le membre.
Reconnaître un état de choc
Un animal en état de choc présente plusieurs symptômes
:
- chute de la température (inférieure à 37°C)
- froideur et bleuissement des extrémités
- réduction de l’émission des urines
- pâleur de la bouche et des yeux
- accélération du rythme respiratoire et cardiaque
- pouls difficilement palpable
- somnolence, coma et convulsions
Diarrhées
Mettre l’animal à la diète durant 24 h, en lui laissant
l’eau. Réalimenter l’animal progressivement à
la suite de la diète à l’aide d’aliments pauvres
en graisses (viandes maigres, poisson, œuf cuit…). Ne redonner
une alimentation normale qu’au bout de 4 à 5 jours de ce
régime.
Attention, s la diarrhée ne cesse pas au bout de 24 h de diète,
consulter un vétérinaire.
Fièvres
- Si la fièvre est associée à d’autres symptômes
(toux, diarrhées, vomissements…) conduire l’animal
chez le vétérinaire assez rapidement.
- Si la fièvre est isolée et tolérée, il n’est
nécessaire d’emmener l’animal chez un vétérinaire
que si elle ne disparaît pas après 24 h.
- Si la fièvre est isolée mais non tolérée,
conduire l’animal chez un vétérinaire.
Ne jamais donner de médicaments à un animal avant une visite
chez le vétérinaire, car ceux-ci pourraient fausser le diagnostic.
IV- Administrer un médicament à
un chat
La trousse vétérinaire de base contient :
- thermomètre
- paire de ciseaux courbes à bouts ronds
- bande Velpeau
- Elastoplaste
- Sparadrap
- Compresses stériles
- Coton hydrophile
- Eau oxygénée
- Dakin
- Mercryl laurilée
- Pommade cicatrisante
Donner un comprimé
Si l’animal est gourmand, il suffit de placer le médicament
dans une boulette de viande. Sinon, il faudra lui faire avaler de force.
- Placer la main au dessus du museau du chat et lui faire ouvrir la gueule
en appuyant avec le pouce et l’index, de chaque côté
de la commissure des lèvres, juste en arrière des crocs.
- Incliner la tête vers le haut
- Dès qu’un espace apparaît entre les dents, abaisser
la mâchoire inférieure avec l’autre main et placer
le comprimé à la base de la langue, au fond de la gorge.
- Fermer rapidement la gueule du chat et masser doucement la gorge pour
l’aider à avaler.
Donner un liquide
Utiliser une seringue en plastique où un compte gouttes. Certains
médicaments fournissent une pipette.
- Décoller la lèvre supérieure du chat et introduire
l’embout de la seringue juste derrière les crocs
- Soulever la tête vers l’arrière et verser lentement
le liquide. Si l’animal tousse, arrêter l’opération.
Collyre
- Débarrasser l’œil de toutes les saletés qui
l’encombrent avec une compresse imbibée d’eau bouillie
refroidie
- Lever la tête du chat tout en baissant légèrement
la paupière inférieure afin de maintenir l’œil
ouvert
- Instiller une où deux gouttes sur la cornée, puis relâcher
la paupière.